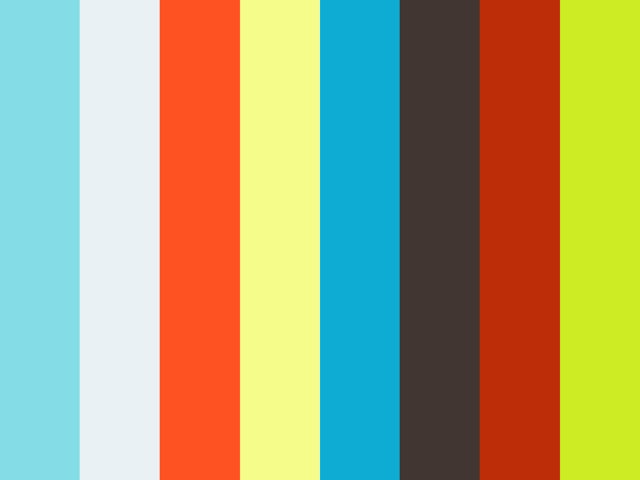Claude Gauvreau est l'un de ces monstres sacrés que l'on révère autant que l'on craint. Poète souvent explosif, dramaturge qui dissèque avec une rare clairvoyance la société dans laquelle il évoluait, essayiste, romancier, épistolier, Gauvreau demeurera toujours un personnage plus grand que nature. Que l'on ait vu une fois ou vingt sa
prestation à la mythique Nuit de la poésie de 1970, impossible de ne pas être renversé à chaque fois par son incommensurable magnétisme. Souvent cité, mais en réalité assez peu monté, Gauvreau est sans doute victime indirecte de sa propre ombre portée.

Belle idée donc de la SMCQ de clôturer sa saison par un hommage en mots et en musique à cet artiste iconoclaste, devant une salle archi-comble. S'y côtoyaient le prélude de la musique de scène de
L'asile de la pureté (enfin monté en 2004 par le TNM, plus de 50 ans après sa complétion!) et sa maintenant bien connue
Valse de l'asile de Walter Boudreau, des extraits de deux pièces phares dans une mise en scène de Lorraine Pintal, la prestation de Gauvreau lors de la Nuit de la poésie et une version pour deux pianos du dernier mouvement du
Concerto de l'asile, créé en janvier 2013 par Alain Lefèvre et l'OSM. L'expérience aurait certes été plus satisfaisante si elle avait été conçue comme un nouvel objet dramaturgique, d'un seul tenant, les applaudissements étant réservés à la toute fin de la proposition.

Que retiendrons-nous essentiellement de cette soirée? La parole, essentielle, de Gauvreau, qu'elle soit suggérée comme dans le prélude de
L'asile de la pureté, brillant collage électroacoustique de Boudreau, auquel se superposaient les voix et les cloches (des feuilles de métal de différentes tailles) de l'Ensemble Mruta Mertsi, ou explicitée, à travers des extraits de
L'asile de la pureté et de
La charge de l'orignal épormyable. François Papineau (qui avait incarné le monumental Mycroft Mixeudeim au TNM en 2009) a démonté ici toute la puissance et la profondeur de son jeu, happant le spectateur en quelques secondes à peine, qu'il joue la carte de la folie démesurée ou de l'intériorité et de la contemplation d'un amour blessé. Superbe idée ici de faire dialoguer les mots de Gauvreau avec la prestation sur instrument inventé d'André Pappothomas (on avait déjà pu tomber sous le charme d'instrument et interprète lors de la production de l'opéra
Notre Damn à l'automne 2014), ces cordes pincées, frottées, détournées, nous permettant d'une certaine façon d'entrer dans la tête de Donatien Marcassillar ou Mycroft Mixeudeim (Gauvreau lui-même).
Alain Lefèvre nous a offert une prestation toute en finesse de la
Valse de l'asile, parfaitement dégagée, tantôt intime, tantôt presque orchestrale, portée par l'ampleur du souffle et la subtilité des multiples rubatos. Il reviendrait sur scène après la projection de la prestation de Gauvreau lui-même, magnétique, qu'il récite en exploréen ou nous livre des textes en apparence plus accessibles, cette fois en compagnie de Matthieu Fortin dans une version pour deux pianos de
« La charge de l'orignal épormyable », dernier mouvement du
Concerto de l'asile. Difficile ici de ne pas regretter la puissance, mais surtout les couleurs de l'orchestre et ce, malgré un soutien irréprochable de Matthieu Fortin, particulièrement raffiné, jouant sur les textures et les couleurs. Si cet arrangement pour deux pianos permet d'appréhender la rythmique complexe du mouvement de l'intérieur d'une certaine façon, l'opposition entre masse orchestrale et piano est nécessaire pour saisir les paliers de l'émancipation de Gauvreau de ses tortionnaires (le deuxième mouvement se passant à Saint-Jean-de-Dieu, rappelons-le) et apprécier au maximum le déploiement de la virtuosité soliste. À quand l'enregistrement avec orchestre?
« La banalité est la loi. L’unique est tabou. Les hommes justes souhaiteraient qu’il fût possible d’expier
d’être unique. Hélas, l’unicité est inexpiable », écrivait Gauvreau dans les premières lignes de son roman Beauté baroque. La soirée d'hier nous a rappelé la pertinence de cette parole certes mordante, mais surtout appel à une prise de conscience tant individuelle que collective.