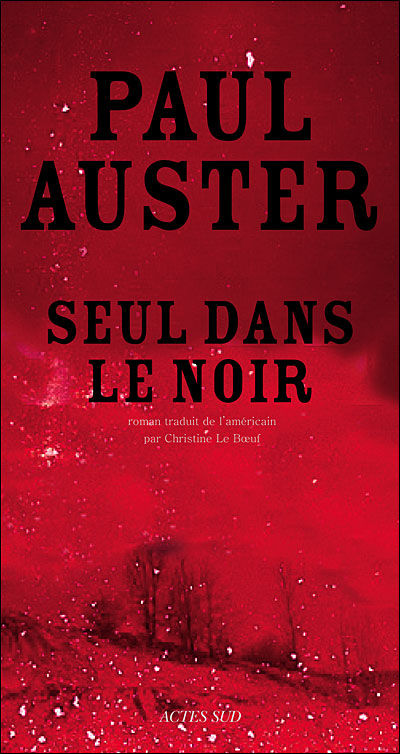Je ne propose pas ici de commentaire de lecture objectif de ce premier roman. Mais est-on jamais réellement objectif face à la lecture d'un auteur ou à l'écoute d'une œuvre musicale? Poser la question, c'est bien sûr y répondre. Si l'on aime un auteur, l'on connaît bien un compositeur, on acceptera avec certes beaucoup plus de grâce les petites faiblesses qui pourraient se glisser entre les pages. Il m'arrive assez souvent d'échanger là-dessus avec des élèves avancés, alors que nous trouvons par exemple un mouvement de sonate de Beethoven lumineux mais que nous avons l'impression que, pendant quatre ou six mesures, tout à coup, la voix semble moins convaincante. Devrait-on abolir ce passage? Bien sûr que non, tout n'est que question de perception et d'interprétation.
Après cette digression, je reviens donc à Adieu, vert paradis d'Alexandre Lazaridès, premier roman commis par un auteur mûr néanmoins, qui a déjà publié un ouvrage de référence sur Valéry et signé de multiples contributions pour la revue Jeu et de nombreuses recensions de disques classiques pour La Scena Musicale. Je suis ici incapable d'opter pour un tant soit peu d'objectivité puisque l'auteur est l'un des mes amis et que je me suis déjà penchée sur deux versions précédentes du manuscrit, tant au point de vue de certains choix de termes que de la structure narrative. Néanmoins, n'ayant plus touché aux ébauches depuis environ deux ans et m'étant contentée de suivre le travail de réécriture et les différentes étapes menant à la publication du titre en amie, j'avais donc eu le temps d'« oublier » certains éléments de ce texte puissant, doté d'un rythme unique, férocement en marge des textes publiés ces jours-ci et j'ai donc pu le réaborder d'une certaine façon sans a priori.
Le narrateur nous amène dans un curieux voyage, vers le passé, vers une enfance troublée par les secrets, les questionnements, mais aussi vers le rêve, l'épopée, la musique, tant classique - traitée avec une tendresse remarquable - que la petite musique des vies qui se déchirent puis tentent de se renouer autrement. Dans une langue riche, particulièrement travaillée, portée autant par un français parfaitement maîtrisé que par le souffle inhérent à la narration des contes orientaux, l'auteur nous mène au plus profond de la psyché des personnages. Quand la violence est abordée (certains éléments de l'intrigue sont particulièrement troublants), elle ne l'est jamais de façon gratuite (et nous restons toujours à des lieues des débauches de détails scabreux qu'on pourrait retrouver dans d'autres pages). En restant volontairement sur la ligne très fine entre le dicible et l'indicible, Alexandre Lazaridès nous force à assumer nos interrogations et tend le fil à son maximum entre fiction et réalité, là-bas et ici, passé suranné et présent assumé.
Pour apprécier le roman, il faut accepter de s'investir, de se couler dans une respiration bien particulière, d'abaisser d'une certaine façon notre pulsation cardiaque, de lire en marge de l'effervescence du monde contemporain afin de retrouver le bouillonnement d'une vie intérieure. Alors, on en ressortira grandi.