Je ne prends jamais de listes imprimées de mes emprunts à la bibliothèque, histoire de sauver du papier, consciente que je recevrai de toute façon un rappel deux jours avant l'échéance. Par contre, il n'y a rien que j'aime plus que de trouver les listes de titres empruntés par la personne ayant eu en main un livre avant moi. J'essaie toujours alors d'établir des correspondances, des liens entre ses choix, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur cet(te) inconnu(e) - dont le nom apparaît sur le bout de papier, mais qui ne révèle aucune importance.
J'aime aussi cette idée que toutes ces autres personnes ont touché ce livre avant moi (de la même façon, j'aime beaucoup être la première à mettre la main sur une nouveauté, tout juste arrivée), que leurs lectures, mais aussi leurs vécus, leurs intérêts, se mêlent à ma perception du livre, la teinte peut-être sans que je ne m'en rende compte, que moi aussi je laisse une part de moi dans ces pages, qu'elles aient été lu dans les transports, dans le jardin, en vacances.
Il y a quelque chose de troublant dans cet acte de partage, intime de par sa nature même (il n'y aura jamais personne d'autre que l'auteur et le lecteur dans cette relation, sauf bien sûr si on choisit de faire la lecture à haute voix à un ami ou un amoureux), quelque chose d'universel qui nous lie les uns aux autres autrement.
La musique et l’écriture ont été de tout temps les deux pôles de la vie créatrice de l'auteure. Ce site se veut donc un hommage à la musique (particulièrement classique) et à la littérature, mais aussi au théâtre et aux autres manifestations artistiques.
vendredi 31 juillet 2015
lundi 27 juillet 2015
Sept d'un coup
Ah, le bonheur des weekends sans rendez-vous, quand le soleil est de la partie... Certains fuient le brouhaha de la ville. J'ai plutôt choisi de voler du temps au temps, bien installée dans mon jardin, malgré les rénovations d'un voisin. Le décompte: trois BD, trois pièces de théâtre et un roman, dernier achat impulsif effectué à ma librairie indépendante préférée il y a deux semaines.
Côté BD, trois styles tout à fait différents. My Depression d'Elizabeth Swados (auteure encensée sur Broadway) n'est en rien sombre et glauque, malgré ses dessins en noir et blanc. L'auteure revient sur une de ses chutes, avec tendresse, humour, de façon rassembleuse. On sourit souvent et on retient certaines choses pour mieux soutenir un ami la prochaine fois.
Belle découverte que celle de Minimax, charmant personnage de François Donatien, musicienne dans un groupe punk-rock le soir, à la maîtrise le jour, fan de vinyles. On s'attache en quelques secondes à l'échevelée aux grosses lunettes carrées et apprécie le trait de crayon alerte.
Autre palette entièrement pour Love in Vain, qui se veut une biographie en noir et très peu de blanc de la vie du bluesman Robert Johnson. On se perd dans la contemplation des dessins (presque des eaux-fortes), en apprend plus sur la vie du musicien, referme le livre avec l'envie de l'écouter (surtout qu'un songbook a été intégré à la fin, avec traductions mêmes pour les moins fluides dans la langue de Shakespeare). Un très bel album!
Si j'ai négligé depuis quelques semaines les salles de théâtre, cela ne m'a pas coupé l'envie d'en lire: trois voix qui ont fait leur preuve, dans des registres très différents. Je n'aurais jamais pensé à Michel Marc Bouchard comme à un auteur léger. Les papillons de nuit relève assurément du théâtre d'été, avec multiplication des quiproquos et portes qui claquent (ou presque, la mère ayant décidé de cirer le plancher du chalet loué, ce qui force tout le monde à rester dehors, de la fille policière aux frères échappés de prison et à l'entomologiste homosexuel). Cul sec de François Archambault se veut un portrait sans concession d'une certaine jeunesse désabusée, à travers l'histoire de trois amis dans la mi-vingtaine partis pour une moyenne soirée de brosse. Finiront-ils par se réveiller avant qu'il ne soit trop tard? L'alcool coule aussi à flots dans Oublier de Marie Laberge, une de ses pièces les plus montées. Quatre sœurs, la maison familiale: un huis-clos étouffant (l'ombre de la mère atteinte d'Alzheimer plane sur toute la pièce), comme on le voit souvent au théâtre, mais rendu avec beaucoup d'habilité. De quoi regretter Marie Laberge la dramaturge...
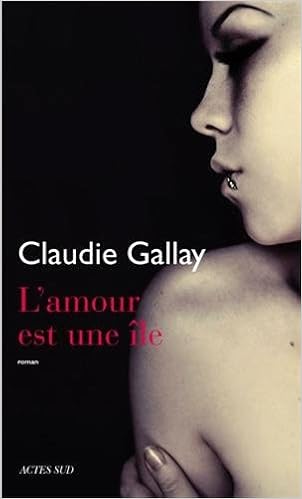 Je me suis finalement plongée dans L'amour est une île de Claudie Gallay qui se passe au Festival d'Avignon, cet été fatidique ou les grèves d'intermittents avaient paralysé l'événement. On y suit Odon, propriétaire d'un petit théâtre, qui n'a jamais réussi à oublier Mathilde, devenue vedette de la scène, les comédiens de sa troupe, l'attachante Isabelle qui a vu passer tous les grands chez elle, sans oublier Marie, la sœur de cet auteur mort quelques jours après avoir envoyé son manuscrit, dont on monte enfin une pièce. Là aussi, on étouffe, autant sous la chaleur que sous le poids des secrets, l'écheveau se dénouant habilement jusqu'au punch final.
Je me suis finalement plongée dans L'amour est une île de Claudie Gallay qui se passe au Festival d'Avignon, cet été fatidique ou les grèves d'intermittents avaient paralysé l'événement. On y suit Odon, propriétaire d'un petit théâtre, qui n'a jamais réussi à oublier Mathilde, devenue vedette de la scène, les comédiens de sa troupe, l'attachante Isabelle qui a vu passer tous les grands chez elle, sans oublier Marie, la sœur de cet auteur mort quelques jours après avoir envoyé son manuscrit, dont on monte enfin une pièce. Là aussi, on étouffe, autant sous la chaleur que sous le poids des secrets, l'écheveau se dénouant habilement jusqu'au punch final.
Côté BD, trois styles tout à fait différents. My Depression d'Elizabeth Swados (auteure encensée sur Broadway) n'est en rien sombre et glauque, malgré ses dessins en noir et blanc. L'auteure revient sur une de ses chutes, avec tendresse, humour, de façon rassembleuse. On sourit souvent et on retient certaines choses pour mieux soutenir un ami la prochaine fois.
Belle découverte que celle de Minimax, charmant personnage de François Donatien, musicienne dans un groupe punk-rock le soir, à la maîtrise le jour, fan de vinyles. On s'attache en quelques secondes à l'échevelée aux grosses lunettes carrées et apprécie le trait de crayon alerte.
Autre palette entièrement pour Love in Vain, qui se veut une biographie en noir et très peu de blanc de la vie du bluesman Robert Johnson. On se perd dans la contemplation des dessins (presque des eaux-fortes), en apprend plus sur la vie du musicien, referme le livre avec l'envie de l'écouter (surtout qu'un songbook a été intégré à la fin, avec traductions mêmes pour les moins fluides dans la langue de Shakespeare). Un très bel album!
Si j'ai négligé depuis quelques semaines les salles de théâtre, cela ne m'a pas coupé l'envie d'en lire: trois voix qui ont fait leur preuve, dans des registres très différents. Je n'aurais jamais pensé à Michel Marc Bouchard comme à un auteur léger. Les papillons de nuit relève assurément du théâtre d'été, avec multiplication des quiproquos et portes qui claquent (ou presque, la mère ayant décidé de cirer le plancher du chalet loué, ce qui force tout le monde à rester dehors, de la fille policière aux frères échappés de prison et à l'entomologiste homosexuel). Cul sec de François Archambault se veut un portrait sans concession d'une certaine jeunesse désabusée, à travers l'histoire de trois amis dans la mi-vingtaine partis pour une moyenne soirée de brosse. Finiront-ils par se réveiller avant qu'il ne soit trop tard? L'alcool coule aussi à flots dans Oublier de Marie Laberge, une de ses pièces les plus montées. Quatre sœurs, la maison familiale: un huis-clos étouffant (l'ombre de la mère atteinte d'Alzheimer plane sur toute la pièce), comme on le voit souvent au théâtre, mais rendu avec beaucoup d'habilité. De quoi regretter Marie Laberge la dramaturge...
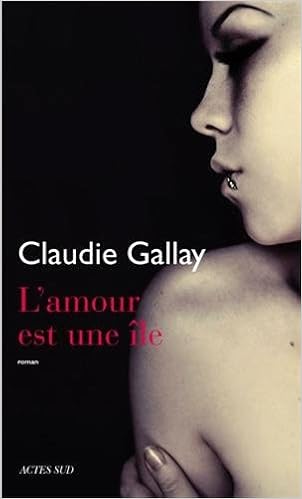 Je me suis finalement plongée dans L'amour est une île de Claudie Gallay qui se passe au Festival d'Avignon, cet été fatidique ou les grèves d'intermittents avaient paralysé l'événement. On y suit Odon, propriétaire d'un petit théâtre, qui n'a jamais réussi à oublier Mathilde, devenue vedette de la scène, les comédiens de sa troupe, l'attachante Isabelle qui a vu passer tous les grands chez elle, sans oublier Marie, la sœur de cet auteur mort quelques jours après avoir envoyé son manuscrit, dont on monte enfin une pièce. Là aussi, on étouffe, autant sous la chaleur que sous le poids des secrets, l'écheveau se dénouant habilement jusqu'au punch final.
Je me suis finalement plongée dans L'amour est une île de Claudie Gallay qui se passe au Festival d'Avignon, cet été fatidique ou les grèves d'intermittents avaient paralysé l'événement. On y suit Odon, propriétaire d'un petit théâtre, qui n'a jamais réussi à oublier Mathilde, devenue vedette de la scène, les comédiens de sa troupe, l'attachante Isabelle qui a vu passer tous les grands chez elle, sans oublier Marie, la sœur de cet auteur mort quelques jours après avoir envoyé son manuscrit, dont on monte enfin une pièce. Là aussi, on étouffe, autant sous la chaleur que sous le poids des secrets, l'écheveau se dénouant habilement jusqu'au punch final.vendredi 24 juillet 2015
Constellation
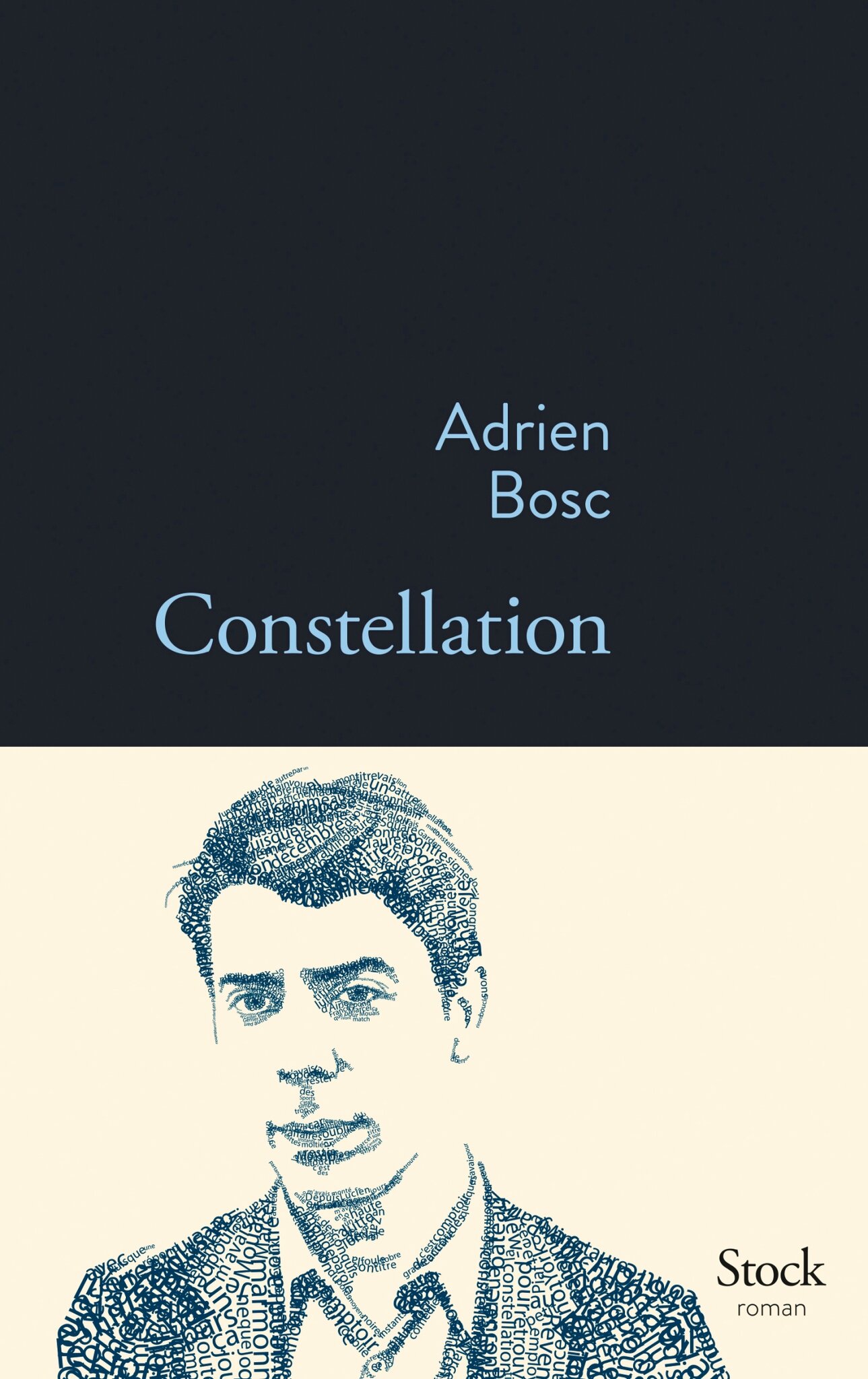 J'ai toujours tendance à me méfier des livres auréolés de prix. Trop de déceptions sans doute au fil des ans. Je fréquente aussi très peu les biographies, romancées ou non, ou encore les reconstitutions de faits. Je préférerai toujours là-dessus un documentaire, surtout s'il est monté avec souffle. J'ai donc hésité quand j'ai trouvé sur les tablettes de ma bibliothèque le premier roman d'Adrien Bosc, Constellation, qui nous fait revivre l'écrasement du F-BAZN d'Air France, dans l'archipel des Açores, dans la nuit du 27 au 29 octobre 1949. Certains fans de boxe ou de Piaf se rappelleront peut-être que Marcel Cerdan était à son bord, mais on a aussi perdu cette nuit-là la violoniste Ginette Neveu et son frère Jean, qui s'apprêtaient à donner un récital au prestigieux Carnegie Hall de New York.
J'ai toujours tendance à me méfier des livres auréolés de prix. Trop de déceptions sans doute au fil des ans. Je fréquente aussi très peu les biographies, romancées ou non, ou encore les reconstitutions de faits. Je préférerai toujours là-dessus un documentaire, surtout s'il est monté avec souffle. J'ai donc hésité quand j'ai trouvé sur les tablettes de ma bibliothèque le premier roman d'Adrien Bosc, Constellation, qui nous fait revivre l'écrasement du F-BAZN d'Air France, dans l'archipel des Açores, dans la nuit du 27 au 29 octobre 1949. Certains fans de boxe ou de Piaf se rappelleront peut-être que Marcel Cerdan était à son bord, mais on a aussi perdu cette nuit-là la violoniste Ginette Neveu et son frère Jean, qui s'apprêtaient à donner un récital au prestigieux Carnegie Hall de New York.Les vies de ces trois célébrités ne valent bien sûr pas plus que celle des 45 autres victimes (dont un journaliste québécois) et c'est là que le roman de Bosc, entre travail d'investigation d'un grand sérieux (on sent dans l'attention portée aux détails le nombre d'heures investies en recherche) et fiction pure, se révèle particulièrement brillant.
On s'attache à cette jeune Amélie Ringler, bobineuse dans une usine de textile se dirigeant vers Detroit, sa marraine fortunée lui ayant laissé un héritage conséquent, à ces bergers basques cédant à l'appât du « rêve américain », à Kay Kamen, celui à qui on doit la commercialisation des produits dérivés Walt Disney. « Entendre les morts, écrire leur légende minuscule et offrir à quarante-huit hommes et femmes, comme autant de constellations, vie et récit. »
Chaque chapitre se lit comme un mini-roman (ou prémisse de), chaque segment offrant un éclairage autre sur la tragédie, comme autant de fragments d'un kaléidoscope complémentaires, mais qui n'apportent pas de réelle réponse. Saura-t-on un jour exactement ce qui s'est passé cette nuit-là? Probablement pas. On se rappellera par contre de l'atmosphère si particulière de cet ouvrage d'Adrien Bosc, en espérant que le prochain soit aussi abouti.
mercredi 22 juillet 2015
Journal de Julie Delporte
 Ma bibliothèque offre depuis quelque temps un espace BD distinct à l'étage des nouveautés, une bien belle idée pour découvrir des romans graphiques notamment. Julie Delporte offre avec ce Journal (disponible en version anglaise chez Koyama Press, en français chez L'agrume) un objet étonnant, d'apparence bricolée (on voit même certaines des marques d'autoadhésif utilisé), dépouillée (quelques mots tout au plus par page), pourtant d'une grande puissance.
Ma bibliothèque offre depuis quelque temps un espace BD distinct à l'étage des nouveautés, une bien belle idée pour découvrir des romans graphiques notamment. Julie Delporte offre avec ce Journal (disponible en version anglaise chez Koyama Press, en français chez L'agrume) un objet étonnant, d'apparence bricolée (on voit même certaines des marques d'autoadhésif utilisé), dépouillée (quelques mots tout au plus par page), pourtant d'une grande puissance. La narratrice se sert de ce journal graphique, réalisé au crayon de couleur (ce qui donne une fausse apparence de dessin enfantin, alors que le geste est assurément maîtrisé), pour mettre derrière elle une relation amoureuse. Au fil des pages, elle mentionnera de moins en moins souvent V, les entrées seront plus espacées, signes d'une convalescence assumée si évidemment pas toujours aisée, qui mènera notamment l'auteure de Montréal au Vermont, alors qu'elle complète une résidence d'écriture.
La narratrice se sert de ce journal graphique, réalisé au crayon de couleur (ce qui donne une fausse apparence de dessin enfantin, alors que le geste est assurément maîtrisé), pour mettre derrière elle une relation amoureuse. Au fil des pages, elle mentionnera de moins en moins souvent V, les entrées seront plus espacées, signes d'une convalescence assumée si évidemment pas toujours aisée, qui mènera notamment l'auteure de Montréal au Vermont, alors qu'elle complète une résidence d'écriture.On a lu des centaines de déclinaisons d'histoires de rupture, bien sûr. Pourtant, celle-là, par sa forme même, sort des sentiers battus, nous permet d'apprivoiser autrement le propos, de comprendre aussi combien une expérience malheureuse peut servir de levier à un projet créateur cohérent, le personnel ici devenant universel, le je de l'auteure se démultipliant en un essentiel nous.
dimanche 19 juillet 2015
L'haleine de la Carabosse: la catharsis par les contes
Les contes se prêtent aux relectures, aux réinterprétations. Ils nous aident à apprivoiser l’innommable, les blessures, les peurs, permettent parfois l’émancipation. C’est du moins ce qu’espère Ève, la narratrice de L’haleine de la Carabosse, roman à clés autant que d’apprentissage
 Certains souhaiteront peut-être recenser toutes les allusions, directes ou indirectes, à ces légendes qui ont bercé leur enfance. Il s’en suivra une lecture inutilement fractionnée, qui freinera l’élan de ce récit qui, même s’il semble s’articuler autour de constants retours en arrière, mène indéniablement son héroïne vers l’avant, vers la nécessaire libération.
Certains souhaiteront peut-être recenser toutes les allusions, directes ou indirectes, à ces légendes qui ont bercé leur enfance. Il s’en suivra une lecture inutilement fractionnée, qui freinera l’élan de ce récit qui, même s’il semble s’articuler autour de constants retours en arrière, mène indéniablement son héroïne vers l’avant, vers la nécessaire libération.
Les contes notés par le père dans son album comme les pans de l’histoire familiale dévoilés au fur et à mesure deviendront autant de petites pierres blanches que l’on sème non pas pour retrouver un passé que l’on recompose de toute façon au fur et à mesure que pour se délester de poids en apparence inconséquents, dont la somme finit par entraver l’avancée.
« Un homme qui ne pouvait être raconté que par d’autres était un homme mort », soutient la narratrice. On serait au contraire tenté d’alléguer que le geste même du récit – qu’il soit fictif ou non importe peu ici –, le maintiendra vivant.
« On rejoue sur ces mythes issus des contes.
On les collectionne comme des pièces honteuses. On les cache. On les barricade dans les musées.
Ça nous reste dans la peau, dans la tête, comme un ver d’oreille. » Un peu comme ce premier roman de Marise Belletête…
vendredi 17 juillet 2015
La marchande de sable: une voix, une vraie
Nous avons très rarement affaire à une voix, distincte, précise, unique; une voix que l’on reconnaît en quelques pages à peine, même si on ne l’a croisée qu’une seule fois auparavant, il y a sept ans de cela déjà. Katia Belkhodja indéniablement est de celles-là. Elle ne fait pas partie de ces romanciers interchangeables qui privilégient une approche formatée du récit. Au contraire, elle se révèle une auteure exigeante, pas tant dans le choix des termes que dans la manipulation même du fil narratif, le lecteur devant faire rapidement fi des codes qu’il considérait acquis pour adopter un rythme différent, sans se laisser démonter par une compréhension d’abord diffuse du propos. Il voudra peut-être reprendre sa lecture du début – la longueur s’y prête –, céder autrement à ces allégories relevant presque du mirage.
Froideur du désert autant que des étendues de glace, ville en mouvement constant qui déstabilise ses habitants, paroles qui ne réussissent jamais à s’affranchir, regards qui figent l’autre dans ses derniers retranchements; ici, temps et espace deviennent synonymes de flou, les images s’affrontent, portées par une langue à l’oralité trafiquée, qui multiplie les détournements, proche de l’incantation. Dans ce lieu fantasmé, on pend les absents, sectionne une part essentielle de soi pour résister à l’envahisseur, mais on continue de croire à la puissance de l’amour, de la vie.
« Peut-être qu’ils s’étaient consommés encore comme des desserts au chocolat avant de séparer leurs peaux l’une de l’autre, les peaux suantes qui refusent et qui finissent par obéir et par se décoller, lentement, avec la tentation, toujours, du raccrochage des peaux et des membres ensemble. »
On voudra assurément y retourner, s’y perdre, s’y découvrir autre.
mercredi 15 juillet 2015
Marise Belletête recrue de juillet
« Lui, peut-être, peut-être qu’il le savait, peut-être qu’il devenait peu à peu un conte pour les autres en oubliant de se plier au réel, en égratignant les souvenirs, en confondant les noms. Par l’écriture, qui rafistolait sa mémoire, il comblait les trous intimidants dans lesquels il craignait de s’abîmer. Tout devenait fiction. Tout devenait vérité. Il se reconstituait au plus vite. Jusqu’à ce que cela devienne vain et lui fasse plus de mal que de bien. »
Les contes jouent un rôle clé dans L’haleine de la Carabosse de Marise Belletête, notre recrue ce mois-ci. Ils permettront notamment à sa narratrice, Ève, de s’émanciper de l’emprise oppressante de sa mère et d’apprivoiser les ombres laissées par ce père parti jadis aux quatre coins du monde transcrire dans son journal les histoires des autres, celles que l’on se raconte le soir au coin du feu, pour oublier notre quotidien, mais aussi pour mieux se comprendre.
Dans son deuxième roman, La marchande de sable, notre ancienne recrue Katia Belkhodja use d’un stratagème semblable, détournant l’essence même de la conteuse Shéhérazade. La fable qu’elle nous propose, qui peut évoquer le désert aussi bien que les grands espaces gelés, favorise les interprétations multiples, une lecture presque contre le grain du texte.
Play Boys de Ghayas Hachem lui aussi s’amuse à détourner les frontières entre les univers, jeu et réalité, guerre réelle et fantasmée. Comme ces adolescents, le narrateur de Même ceux qui s’appellent Marcel de Thomas O. St-Pierre semble à première vue désabusé, en quête d’une identité qu’il peine à cerner. Il est intéressant de juxtaposer son destin à celui de l’héroïne d’un premier roman mythique, L’avalée des avalés de Réjean Ducharme. Bérénice aussi se révoltait contre les horreurs d’un monde qu’elle considérait en perdition. Les temps ont-ils tant changé au fond? Ces titres ont été lus par deux nouveaux collaborateurs, Normand Babin et Charles-David Tremblay, que je me réjouis de voir rejoindre notre équipe de passionnés. Bienvenue à vous deux!
Juillet est synonyme pour plusieurs de vacances. Vous pourrez également choisir de vous évader avec Les Inuits résistants! d’Anne Pélouas, entre essai et récit d’aventures, ou à travers les haïkus du recueil Soupçon de lumière de Danielle Delorme, autant d’instantanés nous rappelant la merveilleuse fragilité de cette vie qui trop souvent nous échappe.
lundi 13 juillet 2015
Bach
« Là, le Concerto pour violon en la mineur, puis celui en mi majeur ont existé pour la première fois. Dans l’âme émerveillée de la petite fille, qui n’avais jamais entendu que du rock & roll et du country, s’est élevé quelque chose comme l’espoir, comme une lumière qu’elle n’avait jamais imaginée. Elle s’est dit : « C’est Dieu. C’est Lui. Il me parle à moi. Il me parle! » Et quand le disque a été fini, elle a prié, d’une voix transfigurée, oubliant la redoutable jointure de madame Dubé :
- Encore, oh! Encore! »
Marie Christine Bernard, Autoportrait au revolver
samedi 11 juillet 2015
Duels
 |
| Photo: Lucie Renaud |
 |
| Photo: Lucie Renaud |
Mon top 3 (cliquez sur les liens pour mes critiques):
1 - Le pianiste
2 - Beyond
3 - Machine de Cirque
 |
| Photo: Lucie Renaud |
vendredi 10 juillet 2015
Quien soy?: gars de la construction
Un cube en bois géant, qui s'évide, se déconstruit, permet d'ériger de nouvelles structures au fur et à mesure. Une contrainte imposée - comme l'était la chaleur extrême dans Warm, présenté il y a quelques jours -, mais un plaisir évident à la transcender. Au fil du spectacle, ces formes deviendront escaliers, tours fragilisées rappelant le jeu de Jenga qui servent de points d'appui, trame sur laquelle projeter des images de gratte-ciels (moment particulièrement magique), boîtes gigognes, tables sur lesquelles jouer aux dés ou tirer au poignet, inspirations pour une série de figures acrobatiques réussies.
Leçon d'architecture certes, mais surtout de poésie, dans laquelle la complicité entre Edward Aleman et de Wilmer Marquez est toujours évidente. Que leurs corps semblent vrillés l'un à l'autre, que les équilibres défient la gravité, que les deux complices bondissent sur un trampoline dissimulé au cœur d'une des structures, on les sent toujours liés, profondément, par leur enfance passée en Colombie, leur perfectionnement en France, à la fois déracinés et profondément ancrés dans un langage commun, développé depuis plusieurs années. Une façon plus intérieure, volontiers méditative, de concevoir le main à main, qui marque assurément les imaginaires.
Jusqu'au 12 juillet au Théâtre Outremont
Leçon d'architecture certes, mais surtout de poésie, dans laquelle la complicité entre Edward Aleman et de Wilmer Marquez est toujours évidente. Que leurs corps semblent vrillés l'un à l'autre, que les équilibres défient la gravité, que les deux complices bondissent sur un trampoline dissimulé au cœur d'une des structures, on les sent toujours liés, profondément, par leur enfance passée en Colombie, leur perfectionnement en France, à la fois déracinés et profondément ancrés dans un langage commun, développé depuis plusieurs années. Une façon plus intérieure, volontiers méditative, de concevoir le main à main, qui marque assurément les imaginaires.
Jusqu'au 12 juillet au Théâtre Outremont
jeudi 9 juillet 2015
Machine de cirque: l'humanité avant tout
 Les attentes se révélaient énormes pour ce premier spectacle éponyme de Machine de cirque et elles n’ont pas été déçues. Scénographie inusitée sans être envahissante, performances exceptionnelles de quatre artistes circassiens aux personnalités fortes (Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo Dario et Maxim Laurin), intégration particulièrement réussie du multiinstrumentiste Frédéric Lebrasseur, dramaturgie cohérente qui incorpore aussi des moments de pure poésie : tout fonctionne parfaitement ici, a été réfléchi, peaufiné, rodé au quart de tour, nous mène irrévocablement vers l’apex.
Les attentes se révélaient énormes pour ce premier spectacle éponyme de Machine de cirque et elles n’ont pas été déçues. Scénographie inusitée sans être envahissante, performances exceptionnelles de quatre artistes circassiens aux personnalités fortes (Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo Dario et Maxim Laurin), intégration particulièrement réussie du multiinstrumentiste Frédéric Lebrasseur, dramaturgie cohérente qui incorpore aussi des moments de pure poésie : tout fonctionne parfaitement ici, a été réfléchi, peaufiné, rodé au quart de tour, nous mène irrévocablement vers l’apex.Pour lire le reste de ma critique, passez chez Jeu...
mercredi 8 juillet 2015
Entre deux eaux: soirée entre amis
La Barbotte. Trois artistes de cirque. Trois parcours différents, néanmoins complémentaires. Le Suisse Philippe Dreyfuss et le Péruvien Gonzalo Coloma ont étudié à l’École nationale de cirque. Le Québécois Andy Giroux s’est perfectionné à Moscou et avec Cirkus Piloterna en Suède. Trois amis qui avaient toujours rêvé de monter un spectacle ensemble, mais qui faute de temps – chacun s’étant produit dans une trentaine de pays avec des compagnies prestigieuses –, n’avaient pu jusqu’ici voir le projet se concrétiser.
Pour lire le reste de ma critique, passez chez Jeu...
Pour lire le reste de ma critique, passez chez Jeu...
mardi 7 juillet 2015
Ruelle: vies parallèles
 |
| Photo: Rolline Lapointe |
Cela donne lieu à de très belles images (la folie du déménagement en début de spectacle), les regards échangés entre la chanteuse Marie-Élaine Thibert (qui se révèle à la hauteur, aussi bien vocalement que dans les numéros d'acrobatie) et son voisin victime d'un accident (alter ego du metteur en scène Jeffrey Hall, qui a vu se dessiner ce spectacle alors qu'il était immobilisé après une chute), les amoureux qui se courtisent sur les cordes à linge, les escaliers que deux artistes enveloppent de draps blancs... Impossible d'oublier le numéro de tissu de Nadine Louis, le drap qui l'enveloppe donnant l'impression d'être une chrysalide (on peut ici y lire une métaphore de l'adolescente prenant son envol) ou ceux de sangles d'Ugo Laffolay, force et poésie s'y juxtaposant adroitement.
Souhaitant offrir une proposition entre théâtre physique et cirque, soutenue par une trame sonore essentielle, Jeffrey Hall a peut-être voulu nous en mettre trop plein la vue. Ainsi, quand il superpose trois groupes de fildeféristes à des mouvements au mât chinois, l’œil ne sait plus où se fixer, perd fatalement un mouvement ou l'autre, parfois spectaculaire. Il faudrait revoir le spectacle plus d'une fois pour en extraire toutes les strates. Si le fil narratif, même si lâchement noué, soutient assez bien le propos au départ (apprivoisement des diverses personnalités, dualité entre intérieur et extérieur des appartements, perceptions erronées que l'on peut entretenir par rapport à l'un ou l'autre), on se perd ensuite entre la projection d'extraits de Rear Window des draps suspendus, celle des photos de participants sur les murs de côté et la montée très rapide, presque explosive, vers la violence brute. (Tel qu'indiqué sur le site du festival, le spectacle est pour un public de 15 ans et plus.) Celle-ci se résout un peu trop facilement en une scène de tai chi collective printanière menée par Bailey Eng sur fond des Béatitudes de Martynov. Le spectacle s'épurera vraisemblablement au fil des représentations, rendant le propos plus intelligible et permettant à la beauté de l'objet de se révéler entièrement.
Jusqu'au 9 juillet à l'Usine C
lundi 6 juillet 2015
Le pianiste: alla bravura
J'attendais avec beaucoup d'impatience cette proposition de la compagnie finlandaise Circo Aereo, coup de cœur au Festival Fringe d’Édimbourg l'année dernière en prime. Comment résister en effet à un personnage de pianiste devenu clown maladroit, surtout quand il est transmis avec autant de brio par le Néo-Zélandais Thomas Monckton!
Le pianiste en queue-de-pie ne réussira à sortir des coulisses qu'à travers un minuscule trou dans le rideau de velours, se cognera dans le lustre à quelques reprises avant d'adopter un autre parcours, tombera en bas du piano car la couverture qui le recouvre - très poussiéreuse - est trop glissante, aura besoin d'aide pour remonter sur scène, ira à la chasse aux la - si - do aigus sur ses partitions, le couvercle ayant été brisé quand Monckton l'aura forcé, finira par dégager celui-ci grâce à une des pédales du piano qui sert de levier. Cela fait rire, beaucoup, jeunes comme moins jeunes. La dame à ma gauche s'exclamait avec autant d'enthousiasme que la petite fille tout juste de l'autre côté de l'allée.
Cela serait sans doute suffisant pour passer un agréable moment, mais c'est dans les détails qui s'accumulent que Le pianiste se révèle véritablement brillant. Thomas Monckton et la metteure en scène Sanna Silvennoinen possèdent tous les deux un vocabulaire circassien développé, qui va bien au-delà de la grimace et des mouvements excessifs du corps. Des éléments d'acrobatie, de jonglerie, d'équilibre, de contorsion, de trapèze, de nanodanse, de corde lisse et de mystification sont intégrés au fil des tableaux à la trame narrative - le pianiste finira-t-il enfin par pouvoir jouer un extrait de la Ballade no 1 de Chopin? On trouvera aussi des références au cinéma muet et au western (on ne verra plus jamais les lutrins ornés de la même manière!) et on prend plaisir à voir détournés tous les codes associés en général au concert classique: les rideaux de velours, le lustre de cristal, les souliers vernis, les bas de couleur, le queue de pie (plus flamboyant que d'habitude), la posture rigide du pianiste qui entre en scène, l'égo parfois surdimensionné de ce dernier (savoureux combat avec l'éclairagiste qui refuse de collaborer), la musique de Chopin, les maniérismes...
Tout cela s'enchaîne avec grand naturel (avec quelques retours en arrière qui agissent comme autant de ponctuation), porté par la maestria et le charisme indéniable de Thomas Monckton qui, dès les toutes premières secondes, séduit le public qui devient complice plutôt que simple témoin. Une nouvelle preuve du pouvoir universel de la musique!
À voir au Centaur d'ici au 9 juillet!
Le pianiste en queue-de-pie ne réussira à sortir des coulisses qu'à travers un minuscule trou dans le rideau de velours, se cognera dans le lustre à quelques reprises avant d'adopter un autre parcours, tombera en bas du piano car la couverture qui le recouvre - très poussiéreuse - est trop glissante, aura besoin d'aide pour remonter sur scène, ira à la chasse aux la - si - do aigus sur ses partitions, le couvercle ayant été brisé quand Monckton l'aura forcé, finira par dégager celui-ci grâce à une des pédales du piano qui sert de levier. Cela fait rire, beaucoup, jeunes comme moins jeunes. La dame à ma gauche s'exclamait avec autant d'enthousiasme que la petite fille tout juste de l'autre côté de l'allée.
Cela serait sans doute suffisant pour passer un agréable moment, mais c'est dans les détails qui s'accumulent que Le pianiste se révèle véritablement brillant. Thomas Monckton et la metteure en scène Sanna Silvennoinen possèdent tous les deux un vocabulaire circassien développé, qui va bien au-delà de la grimace et des mouvements excessifs du corps. Des éléments d'acrobatie, de jonglerie, d'équilibre, de contorsion, de trapèze, de nanodanse, de corde lisse et de mystification sont intégrés au fil des tableaux à la trame narrative - le pianiste finira-t-il enfin par pouvoir jouer un extrait de la Ballade no 1 de Chopin? On trouvera aussi des références au cinéma muet et au western (on ne verra plus jamais les lutrins ornés de la même manière!) et on prend plaisir à voir détournés tous les codes associés en général au concert classique: les rideaux de velours, le lustre de cristal, les souliers vernis, les bas de couleur, le queue de pie (plus flamboyant que d'habitude), la posture rigide du pianiste qui entre en scène, l'égo parfois surdimensionné de ce dernier (savoureux combat avec l'éclairagiste qui refuse de collaborer), la musique de Chopin, les maniérismes...
Tout cela s'enchaîne avec grand naturel (avec quelques retours en arrière qui agissent comme autant de ponctuation), porté par la maestria et le charisme indéniable de Thomas Monckton qui, dès les toutes premières secondes, séduit le public qui devient complice plutôt que simple témoin. Une nouvelle preuve du pouvoir universel de la musique!
À voir au Centaur d'ici au 9 juillet!
vendredi 3 juillet 2015
Beyond: y croire
 |
| Photo:Agence QMI |
Beyond n'est toutefois pas une démonstration de force - même si celle des interprètes reste indéniable. On nous invite plutôt à plonger dans un entre-deux, entre réalité et rêve, à retrouver cette part d'enfant enfouie (souvent trop profondément) en nous, l'émerveillement que l'on peut ressentir quand on ouvre un coffre de jouets et que nous avons l'impression que nos peluches sont dotées d'une vie bien à eux.
Que l'on tente de se réveiller d'un cauchemar traumatisant (numéro de chutes calibrées qui se transforme en moment de grande beauté quand l'artiste exécute des figures avec une simple feuille de papier), que l'on soit dans la franche rigolade (délire animal des protagonistes ou jonglerie doublée de contorsion avec balles et raquette de tennis) ou dans la magie pure (sangles aériennes doublées de contorsion ou encore numéro de ruban alors que, dans les premiers instants, l'artiste donne l'impression de grimper à une voile) importe peu ici: le rêve sert assurément de fil conducteur. Détaché de la réalité, on se laisse fasciner par ce qui se passe sur scène, en oublie même de respirer ou d'applaudir, histoire de ne pas briser la concentration de l'interprète parfois (comme dans ce numéro d'équilibre les yeux bandés, les cannes étant disposées à des hauteurs différentes), le plus souvent par peur de briser le sortilège.
 |
| Photo: Agence QMI |
Portés par une musique souvent rétro, qui accentue le côté décalé, voire surannée, de la proposition, les numéros se déploient, non pas par paliers - chaque prouesse déclassant la précédente -, mais avec une grande fluidité. Même quand ils accomplissent des choses en apparence impossibles (du moins, pour le commun des mortels), les interprètes le font avec une telle aisance que nous pouvons nous identifier à eux. Ne souhaitons-nous pas tous laisser notre animal intérieur s'exprimer, porter des têtes d'animaux plutôt que notre masque policé ou nous défaire d'un costume bien trop encombrant comme ce nounours tentant de grimper au sommet du mât chinois? Un instant, fugace, nous aurons l'impression de ne faire qu'un avec eux, de pouvoir faire fi de l'absurdité du quotidien, de
prendre avec eux notre envol.
prendre avec eux notre envol.
Jusqu'au 5 juillet à la TOHU.
jeudi 2 juillet 2015
Gloire et déchéance des grandes puissances
« Les gens conservaient leurs livres, songea-t-elle, non pas parce qu’ils avaient le projet de les relire, mais bien parce que ces objets étaient les dépositaires de leur passé – la texture du moi à une époque et à un endroit donnés, chaque volume une fraction d’un intellect, que l’ouvrage ait été aimé ou détesté, ou qu’il ait provoqué un vaste dodo dès la page quarante. Les gens avaient beau être prisonniers de leur tête, ils passaient leur vie à tenter de s’échapper de cette pièce close. C’est pour cette raison qu’ils avaient des enfants et souhaitaient posséder un lopin de terre; c’est aussi pour cette raison que, après un long voyage, rien ne valait la sensation de retrouver son lit. »
 J'avais adoré le premier roman de Tom Rachman, Les imperfectionnistes, opus particulièrement brillant qui nous plongeait dans l'effervescence d'une salle de rédaction. Impossible donc de ne pas jeter un coup d’œil à celui-ci, malgré une couverture plus ou moins attrayante.
J'avais adoré le premier roman de Tom Rachman, Les imperfectionnistes, opus particulièrement brillant qui nous plongeait dans l'effervescence d'une salle de rédaction. Impossible donc de ne pas jeter un coup d’œil à celui-ci, malgré une couverture plus ou moins attrayante.Aucun doute, on reconnaît la plume incisive de Rachman, qui adopte de nouveau une narration fragmentée qui nous fait passer au fil des chapitres en 1988, 1999 (au moment charnière du basculement vers l'an 2000) et 2011. Le passé de Tooly, une sympathique et lunatique libraire, se révèle par à-coups - parfois même par coups d'éclat -, nous fait voyager à Bangkok, à New York, au Pays de Galles, en Irlande, en Italie. Ballottée d'un lieu à l'autre, incapable d'établir des liens affectifs durables (parents et adultes signifiants dans sa vie n'ont certes pas prêché par l'exemple), elle cherche à se réinventer aussi bien qu'à se retrouver.
On a parfois l'impression que Rachman a visé trop grand ici, en choisissant d'intégrer de multitudes de réflexions philosophiques et politiques à la narration (déjà non linéaire) et en multipliant les lieux (ce qu'on retrouvait aussi dans son livre précédent). S'il faut parfois s'accrocher pour ne pas décrocher de ce roman de plus de 600 pages, le charme opère en grande partie grâce à une galerie de personnages plus grands que nature, auxquels on s'attache malgré leurs - nombreux - travers.
Inscription à :
Commentaires (Atom)





